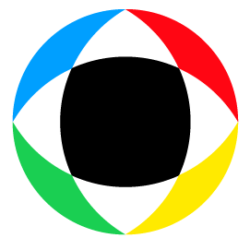La synthèse « Avoir deux langues et plus à l’école maternelle et élémentaire », rédigée par Ranka Bijeljac‑Babic et Nathalie Auger, publiée par le Conseil scientifique de l’éducation nationale en janvier 2025, révèle une vérité aussi simple que profonde. Beaucoup d’enfants qui, à l’entrée en maternelle, ne maîtrisent pas encore le français possèdent déjà, grâce à leur famille, une ou plusieurs compétences langagières dans une ou plusieurs langues. Ces compétences ne sont pas des handicaps mais des ressources à activer et à valoriser pour enrichir l’apprentissage du français à l’école.
Le document pose la question suivante : comment intégrer dans la pédagogie française les aptitudes linguistiques et culturelles des langues maternelles ou familiales que les enfants bilingues apportent ? Pour y répondre, il s’appuie sur des données scientifiques récentes, sur des pratiques éducatives et sur des pistes concrètes de réflexion. L’objectif est non seulement de soutenir l’acquisition du français, mais aussi de permettre à l’enfant bilingue d’exploiter toute la richesse de son répertoire linguistique, pour sa réussite scolaire et son bien‑être.
La recherche démontre que le bilinguisme chez l’enfant offre des avantages majeurs. Dès la petite enfance, les enfants exposés à plusieurs langues traversent les mêmes étapes d’acquisition linguistique que les enfants monolingues, à condition que l’exposition soit de qualité et suffisante. Leur progression en français se fait rapidement, surtout quand l’école reconnaît et valorise les autres langues qu’ils parlent. Le bilinguisme stimule également la conscience métalinguistique, c’est‑à‑dire la capacité de réfléchir sur la langue, ses usages et sa structure, ce qui permet de mieux comprendre le français et d’apprendre plus efficacement dans les différentes disciplines.
Les auteurs soulignent aussi les difficultés possibles, notamment quand les conditions socio‑économiques sont défavorables, ou quand l’enfant n’est pas soutenu dans ses langues familiales. Mais ces obstacles ne seraient pas insurmontables si l’école s’engageait dans une démarche inclusive, formant ses enseignants, valorisant les langues des élèves, impliquant les familles et favorisant des environnements linguistiques riches.
Parmi les méthodes proposées figure ce que les auteurs appellent le diamant langagier. C’est un modèle pédagogique qui combine plusieurs facettes pour créer un environnement de classe plurilingue et culturellement riche. Le diamant permet de faire que l’identité linguistique de l’élève ne soit pas cantonnée à la maison, mais serve de pont vers l’apprentissage du français et vers tous les savoirs scolaires, en articulant les langues familiales, les langues régionales et le français de l’école.
En conclusion, ne pas ignorer ni dévaloriser les langues familiales, mais les considérer comme des leviers pédagogiques, c’est offrir aux enfants bilingues une école qui les comprend, qui reconnaît leur diversité, et qui les aide à progresser dans toutes les disciplines, pas seulement en français.
Les auteurs, Ranka Bijeljac‑Babic et Nathalie Auger, proposent que l’école prenne conscience que le bilinguisme n’est pas un défaut mais une richesse. Ils invitent à utiliser les langues maternelles comme levier pour le français, à soutenir les familles, à former les enseignants, et à instaurer des pratiques éducatives inclusives comme le diamant langagier. Une démarche de ce type pourrait transformer l’école en lieu de réussite pour tous les élèves, quelle que soit leur langue de naissance.